Constamment, je me demande si la foi religieuse est innée, ancrée en nous, ou façonnée par des facteurs externes comme la culture et l’environnement. Si l’on examine les arguments en faveur d’une religiosité innée, nous pourrions avoir évolué et développé une tendance à attribuer les événements naturels à des forces surnaturelles, comme des dieux ou des esprits, tout comme nos ancêtres expliquaient les orages comme la manifestation de dieux en colère.
Certaines théories affirment également que notre cerveau est programmé pour lire les pensées d’autrui, rendant intuitive la croyance en des divinités invisibles et conscientes. Certaines études suggèrent également que la spiritualité peut être héréditaire, tandis que les neurosciences montrent que la stimulation du lobe temporal peut déclencher des expériences mystiques. Néanmoins, je pense que la religion est davantage influencée par l’apprentissage culturel et social.
Le meilleur exemple est que les enfants adoptent généralement la religion et la culture générale de leurs parents. Un enfant né en Arabie saoudite sera probablement musulman, tandis que celui né près de chez nous à Provo, dans l’Utah, sera immanquablement mormon ! Même chose pour moi quand j'ai grandi en France et que je n’ai pas eu d'autre choix que d'être enrôlé dans la foi catholique.Il y a aussi l'aspect social de la religion organisée, avec ses rites et ses traditions qui crée une certaine cohésion au sein des communautés. L'attrait principal de la religion est qu'elle répond à l'angoisse existentielle en atténuant la peur de la mort, à tel point, me dit-on, que dans les sociétés à forte mortalité, les gens ont tendance à être plus religieux. L'inverse est vrai dans les pays bien gouvernés, plus avancés et très stables comme la Scandinavie.
Entre ces deux forces, certains chercheurs s'accordent à dire que la religiosité découle à la fois de tendances innées et d'un façonnement culturel, et affirment que notre structure cérébrale et nos biais cognitifs nous rendent enclins aux croyances surnaturelles. Je suis un peu sceptique à ce sujet et je crois que c'est la culture et les pressions sociales qui déterminent quels dieux, quels rituels ou quels systèmes moraux dominent.
Il y a aussi ceux qui évoquent les expériences de mort imminente, expliquées par un phénomène biologique lié au manque d'oxygène et conduisant aux histoires de « tunnel de lumière » dont nous avons tous entendu parler, comme étant la porte d'entrée vers le « paradis » chrétien ou le « bardo » bouddhiste. Dans le même ordre d'idées, il existe bien sûr les effets de la prière et de la méditation, dont les effets neurologiques sont mesurables, mais ces pratiques ne sont pas instinctives et doivent être enseignées.
S'il est certain que la foi religieuse n'est ni purement innée (comme la faim), ni purement acquise (comme l'algèbre), certains facteurs rendent les humains sensibles aux croyances surnaturelles, et notre environnement détermine la forme spécifique que prennent ces croyances. Qu'en pensez-vous ?






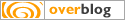

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire