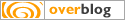Bien que le terme « rivière atmosphérique » n'existait pas au XIXe siècle, il existe des preuves historiques indéniables de leurs effets dévastateurs. Ces phénomènes ont commencé avec la grande inondation de 1862, la plus importante jamais enregistrée en Californie, Oregon et Nevada. Elle avait été causée par une succession de rivières atmosphériques qui ont transformé la vallée centrale de Californie en véritable mer intérieure.
Auparavant, grâce à l'étude des cernes des arbres et des couches de sédiments, les scientifiques avaient déjà identifié des incidences de « méga-rivières atmosphériques » remontant jusqu'à l'an 212, ce qui suggère qu'elles ont toujours constitué une caractéristique constante du climat terrestre depuis la nuit des temps.Au cours de la dernière décennie, notre compréhension est passée de la simple « découverte » à la « classification ».
En 2019, le Dr F. Martin Ralph et ses collègues de l'Institut d'océanographie Scripps, près de San Diego, avaient mis au point l'échelle des rivières atmosphériques (de 1 à 5).
À l'instar de l'échelle des ouragans, elle permet au public de comprendre si une rivière atmosphérique imminente sera « bénéfique » (remplissant les réservoirs et protégeant des sécheresses) ou « dangereuse » (provoquant inondations et glissements de terrain).
Des études scientifiques récentes confirment que les rivières atmosphériques deviennent plus fortes, plus chargées d’humidité, plus intenses et plus fréquentes ces dernières années. La principale cause est le changement climatique d'origine humaine.Une atmosphère plus chaude retient davantage d'humidité, alimentant ces « rivières du ciel » en vapeur d'eau supplémentaire provenant des océans, ce qui provoque précipitations, inondations et vents violents, affectant particulièrement la côte ouest des États-Unis.
Combiné à l'augmentation constante des températures, il est désormais à peu près certain que ce phénomène entraînera une diminution progressive de l'enneigement dans nos montagnes de la Sierra Nevada, aux Cascades et dans toutes les Rocheuses aux États-Unis.
Habitant à Park City, une région montagneuse, je souhaite savoir comment les rivières atmosphériques affectent spécifiquement notre manteau neigeux et le risque d'inondation dans notre communauté montagnarde, par rapport aux zones côtières. Nous aborderons ce sujet dans notre prochain article de blog, donc restez bien connectés !